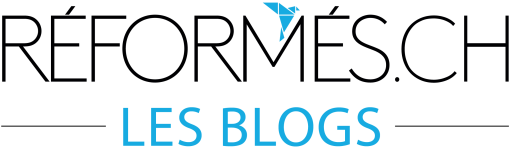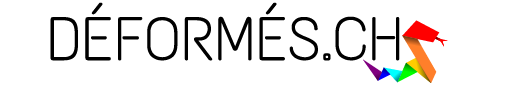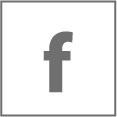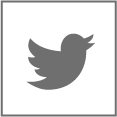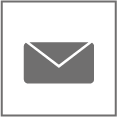Revendications des femmes protestantes du 14 juin 2023
? FORMULAIRE POUR SIGNER LES REVENDICATIONS
Grève des femmes 14 juin 2023
Revendications des femmes de l’Église protestante de Genève
Nous, femmes de l’Église protestante de Genève et hommes alliés, voulons prolonger le travail de conscientisation et de transformation amorcé par la Grève de 2019.
Une fois encore, et parce que l’égalité est encore un horizon, nous voulons prendre la parole et la plume pour porter nos revendications. Ces revendications sont la déclinaison pour notre Église des revendications portées par la Collective interreligieuse du 14 juin 2023. Cette Collective s’est formée à l’automne 2022 afin de préparer la participation commune des femmes de différentes religions. Elle est un lieu de partage, de ressourcement, d’encouragement et d’empuissancement entre sœurs suivant des chemins spirituels différents.
Pour cette Grève 2023, nous nous appuyons particulièrement sur la sororité, qui est source de force et d’encouragement pour une prise de parole publique et spirituelle de la part de toute femme croyante. Nous nous unissons au concept d’empuissancement, mis en avant par les Femmes protestantes en Suisse (FPS) pour cette année 2023.
Nous portons l’espérance que notre Église, ses instances et ses membres continuent d’être sources d’inspiration, d’action et d’engagement avec et pour toutes les femmes qui subissent des discriminations et qui cherchent à les dépasser pour créer une société et une Église plus justes.
Nous nous réjouissons de la pleine égalité entre femmes et hommes au sein de notre Église, tant au niveau réglementaire que statutaire. Nous sommes fières que, dans notre Église, des femmes, aussi bien laïques que ministres, puissent incarner une autorité institutionnelle, spirituelle et/ou théologique.
__________________________________________________________________________
Revendication 1: une sensibilisation aux discriminations liées au genre dans notre institution
Il est nécessaire de proposer une sensibilisation aux discriminations de genre, encore largement minimisées par nombre de personnes au sein de notre Église. Engagées dans le combat féministe, nous voulons aussi souligner l’importance de sensibiliser aux autres formes de discriminations, notamment liées à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou à l’origine ethnique, ainsi qu’au fait que des personnes subissent plusieurs de ces discriminations (ce qu’on appelle l’intersectionnalité). Il est nécessaire de conscientiser les biais qui nous empêchent de les reconnaître et donc de les combattre1.
Suite aux revendications exprimées les années précédentes, une sensibilisation à la problématique des violences sexuelles a été mise en place et rendue obligatoire pour toutes les personnes en charge de groupes de catéchèse. Cette formation, assurée par l’association ESPAS, est un vrai pas en avant. Le pas suivant pourrait être l’engagement de l’EPG dans la démarche portée depuis de nombreuses années par le Conseil Œcuménique des Églises «Les jeudis en noir», déjà soutenu et mis en pratique par un petit groupe de personnes engagées.
Revendication 2 : un langage plus inclusif
Cette revendication a déjà été formulée en 2019 et en 2020, mais n’a jusqu’à aujourd’hui eu que très peu de résultats concrets. Elle comporte deux volets :
pour parler des êtres humains : nous voulons un langage inclusif qui fasse une place à la moitié de l’humanité invisibilisée par l’usage du masculin dit neutre. De nombreux organismes publics, parapublics et privés ont pris ce virage2, appuyés par les nombreux travaux scientifiques qui montrent que notre cerveau, quand il entend du masculin, se représente des êtres de sexe masculin3. Notre Église ne l’a pas encore fait et nous le regrettons. Nous demandons que notre Église utilise le langage inclusif dans tous ses supports de communication, y compris les liturgies et les pratiques catéchétiques. Le langage inclusif englobe de nombreuses pratiques différentes, qui vont bien au-delà de l’usage des tirets et autre points médians (par exemple, on pourrait mettre sur les certificats de mariage «Date de naissance» plutôt que «né/née»). Une formation de l’ensemble du personnel de l’Église est nécessaire sur cette question4.
pour parler de Dieu : nous voulons une diversification des manières de parler de Dieu, qui rende mieux compte du fait que les approches bibliques pour dire Dieu sont bien plus riches que nos liturgies ne le laissent généralement transparaître. Dieu résiste à toute tentative de le fixer dans une image unique. La Compagnie des pasteur.es, des diacres et des chargé.es de ministère a entamé à l’automne 2021 une réflexion sur cet aspect. La presse s’étant emparée, à sa manière, du sujet, il est devenu extrêmement polémique et a été peu soutenu en dehors de la Compagnie.
Malgré la demande des auteurices, l’office de la Compagnie qui a fait couler tant d’encre sans que personne ne l’ait lu n’a toujours pas pu être publié pour rendre la démarche transparente et permettre des discussions plus constructives. La Compagnie a néanmoins poursuivi sa réflexion et proposera le 5 octobre 2023, en collaboration avec la Faculté autonome de Théologie Protestante de l’Université de Genève une journée d’étude intitulée « Quels langages pour dire Dieu ? Genre, Parole et christianisme ». Nous demandons un soutien plus engagé de notre Église à ce travail de conscientisation, qui ne vise pas à imposer une liturgie officielle – chaque lieu et chaque ministre ont leurs usages – mais à alimenter la réflexion théologique et le renouvellement des pratiques liturgiques.
Revendication 3 : une attention à la représentativité de toutes les instances de notre Église
La gouvernance de notre Église devrait être mieux partagée, plus inclusive et plus transparente. Les femmes ne sont pas encore présentes dans tous les lieux d’autorité. Par exemple, actuellement les secrétaires généraux, postes-clés, sont des hommes. Nous voulons que dans les prochains recrutements, tant à des postes rémunérés qu’à des postes bénévoles, une attention soit donnée à favoriser le genre sous-représenté pour que la mixité se concrétise dans toutes les instances décisionnelles. La mixité, reflet de la diversité de notre Église, s’entend également en termes de genre, mais aussi d’âge, d’origine, etc.
Nous voulons que, tant dans le développement de la mission de l’Église que dans les décisions RH, les enjeux autour des discriminations et en particulier celles faites envers les femmes soient pris en compte.
Nous appelons à réaliser une analyse interne au sein de l’EPG pour évaluer les lieux et postes dans lesquels les hommes sont plus représentés que les femmes (trésorier, président de conseil, président de pastorale,...). Pour favoriser la présence des femmes aux postes d’autorité, il faut réfléchir à une juste mesure de l’engagement bénévole et professionnel, réaliste et compatible avec une vie professionnelle et familiale, qui permette un équilibre des différentes sphères de notre vie et la préservation de la santé psychique.
En 1979, quatre diacres (toutes des femmes) et neuf pasteur·es (dont deux femmes) qui demandaient la consécration dans notre Église prononçaient ces paroles, qui nous paraissent toujours pertinentes :
«Y a-t-il place dans l’Église pour la diversité, la contestation et l’innovation ? »
À ces questions, aujourd’hui, nous répondons oui.
Oui, il est possible d’être au service les uns des autres.
Oui, il est possible que les hommes n’écrasent pas les femmes.
Oui, il est possible que les ministres ne dominent pas les laïcs.
Oui, il est possible que dans l’Église, chacun trouve sa parole et soit reconnu. Ce que nous vivons déjà en est le signe.
***
Mais il reste un long chemin à parcourir.
Car il y a encore beaucoup de pouvoir à abandonner et à partager.
Pour y parvenir, il nous faudra apprendre encore à nous reconnaître les uns les autres, et à oser nous faire confiance.5
Revendication 4 : un·e responsable/référent·e égalité au sein du Conseil du Consistoire
Pour que ces revendications ne restent pas lettre morte et que nous n’ayons pas à les reprendre telles quelles l’année prochaine, il faut qu’une personne se sente responsable du suivi de leur mise en œuvre au sein du Conseil du Consistoire.
Les personnes engagées dans la Collective se tiennent à la disposition du Consistoire et du Conseil du Consistoire pour discuter de ces revendications et de leur mise en œuvre.
- Le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences du Canton de Genève organise des formations ; c’est aussi le cas de plusieurs professeures à la Haute école de travail social
- Voir la directive adoptée par l’Université de Genève en 2020 : https://www.unige.ch/rectorat/egalite/thematiques/communication-inclusive-et-epicene/ Et aussi, EERS, Accueillir en mots et en images, qui cite la directive unige https://www.evref.ch/fr/publications/accueillir-en-mots-et-en-images/
- Voir notamment les psycholinguistes : Pascal Gygax, Sandrine Zufferey et Ute Gabriel, Le cerveau pense-t-il au masculin ?, Paris, éd. Le Robert, 2021 ; l’historienne Éliane Viennot, Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! Petite histoire des résistances de la langue française, Donnemarie-Dontilly, éd. iXe, 2014.
- Par exemple avec l’institut DécadréE, spécialisé dans la communication.
- Récit prononcé lors de la Fête, retranscrit dans Fête dans l’Église, Échos d’une consécration, Bulletin du Centre protestant d’études, 31e année, n° 6, novembre 1979, pp. 46-47.
? FORMULAIRE POUR SIGNER LES REVENDICATIONS
Le délai de signature est prolongé jusqu'au jeudi 21 septembre 2023, date du Consistoire lors duquel les revendications seront discutées